La Semiotique Discursive
SOMMAIRE
1/ Quelques
repres historiques
Brve histoire de la smiotique greimassienne
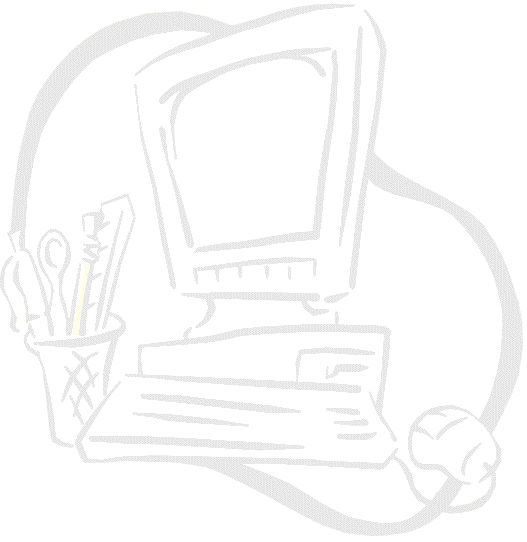 Saussure : le signe, la
smiologie
Saussure : le signe, la
smiologie
Hjelmslev : forme, substance,
plan de lĠexpression et du contenu
Greimas : la smantique
structurale
Autres smiotiques et smiologies : repres historiques et bibliographiques
La smiotique percienne
La thorie smantique dĠUmberto Eco
La smiologie
Evolution des applications, la smiotique greimassienne
Annexe 1 une prsentation historique et conceptuelle de la smiotique
2/ Les
principaux concepts de la thorie greimassienne
Parcours gnratif de la signification
Une carte pour le territoire
smiotique
Pourquoi gnratif ?
La dimension narrative : petite histoire et
principaux concepts
La morphologie du conte de Propp
comme origine de la smiotique narrative
Greimas lecteur de Propp : vers
une plus grande abstraction
Diffrence entre actant et acteur,
transformations transitives et rflexives
Le programme narratif (PN)
Composante narrative : schma dĠensemble
Les modalits de faire
Une application de la mthodologie narrative au
Ç Petit Poucet È
3/ Introduction
la smiotique discursive : lĠnonciation
lĠnonciation en smiotique
LĠopration nonciative
fondamentale : le dbrayage
Enonciation nonce et nonc
nonc : le simulacre nonciatif
Typologie nonciative
Le pragmatique et le cognitif
LĠaspectualisation et lĠinstance
nonciative
Premire typologie des observateurs
4/ Analyse
smiotique applique au texte littraire
Prsentation des textes soumis lĠanalyse
Exemples dĠanalyses
La discursivisation applique Cap Caubert
5/ Analyse
smiotique applique au texte publicitaire
La Smiotique Discursive
___________________________________________________________________________
1/ Quelques
repres historiques
1.1 Brve
histoire de la smiotique greimassienne
1.1.1
Saussure : le
signe, la smiologie
En 1916 Saussure (Cours LG) souhaite une
science qui tudierait Ç la vie des signes au sein de la vie
sociale È : la smiologie qui
engloberait la linguistique. Ç Elle nous apprendrait en quoi consiste les
signes, quelles lois les rgissent.(É)Les lois que dcouvrira la smiologie
seront applicables la linguistique. È Ç Le signe unit non une
chose et un nom mais un concept –signifi- et une image acoustique –signifiant-. È Ç Le signe est une entit psychique 2
faces. È Ç Le lien unissant le signifi et le signifiant est
arbitraire, immotiv. È Lorsque les sons et les ides sont articuls
ensemble par la langue, ils constituent des formes amorphes. Les 2 plans
inarticuls de la pense et des sons sont appels substances par Saussure.
1.1.2
Hjelmslev :
forme, substance, plan de lĠexpression et du contenu
En 1943 le linguiste danois dveloppe la glossmatique qui reprend le dveloppement du concept de signe chez
Saussure pour lĠintgrer une reprsentation plus large du fonctionnement de
la langue. Il voit la langue comme une mise en forme conjointe dĠunits sur le
plan conceptuel (la pense, les ides) et sur le plan phonique (les sons). Il
reprend les concepts de forme et de substance mais nie le ct amorphe. Pour lui la substance nĠest pas
dissociable de la forme, elle est ce qui reste de la mise en forme mais ne lui
prexiste pas.
Le signifiant et le signifi saussurien
correspondent peu prs chez Hjelmslev la forme de lĠexpression et la
forme du contenu. LĠinnovation consiste prendre en considration la relation
de solidarit qui existe entre ces 2 formes : il lĠappelle fonction
smiotique.
Dans la perspective hjelmslevienne, la phonologie devient lĠtude des formes de lĠexpression et la phontique celle de la substance de lĠexpression. La fonction smiotique est celle qui unit les 2 formes de lĠexpression lĠune lĠautre.
Le postulat dĠisomorphisme : pour Hjelmslev la structuration du plan de lĠexpression
revt la mme forme que celle du plan du contenu, ce qui ouvre alors la voie
une smantique (appele structurale) par le simple transfert des distinctions
constates au plan de lĠexpresion et des distinctions au plan du contenu. cd
que les 2 plans peuvent tre structurs par des relations identiques.
1.1.3
Greimas : la
smantique structurale
En 1966 il publie Smantique structurale, considr comme lĠouvrage fondateur de la thorie
smiotique (dans lequel il reprend son compte le postulat dĠHjelmslev sur
lequel il sĠappuie pour construire les fondements dĠune smiotique
structurale). Il sĠagit dĠune thorie de la signification, qui a pour but de
dcrire la structure du plan de lĠexpression (du signifiant).
1.2 Autres
smiotiques et smiologies : repres historiques et bibliographiques
La smiotique greimassienne est lĠun des 2
grands courants smiotiques modernes. Dveloppe en franais, partir du
groupe de recherches en smio-linguistique, constitu autour du sminaire de
Greimas qui se tenait Paris, elle sĠest tout naturellement appele Ç Ecole
de Paris È.
1.2.1
La smiotique
peircienne
Le 2nd grand courant smiotique
est anglo-saxon, il sĠagit de la smiotique peircienne[1].
Elle revendique lĠide dĠune galit des signes, linguistiques ou non ;
les signes dont elle parle sont les signes du monde. Elle se prsente comme une
philosophie du signe et au-del, de la smiose, cd de lĠopration
dĠattribution de sens lĠobjet dĠune perception. CĠest une smiotique gnrale
qui peut sĠappliquer au cas particulier de la linguistique.
1.2.2
La thorie
smantique dĠUmberto Eco[2]
Il se dit redevable aux propositions de
Peirce mais prsente une thorie plus Ïcumnique o il tente dĠinscrire les
propositions de Peirce sur le signe dans un dialogue avec la rflexion
philosophique.
1.2.3
La smiologie
Smiologie de la signification
Principalement reprsente par les travaux de
Roland Barthes (1915/1980), qui, hritier de Saussure et Hjelmslev, se dtache
des prtentions de Greimas pour constituer ce qui sĠapparente plus une
esthtique principalement littraire mais galement socio-discursive.
Smiologie de la communication
Reprsente essentiellement par Georges
Mounin et Luis Prieto elle nĠa produit que des analyses de systmes
smiologiques ferms (ex. : code de la route, systme hraldique[3])
du fait de ses postulats[4].
Elle ne conoit que les codes au sens strict du terme, d un systme de
signaux o un lment correspond une signification. Elle gage sa mthodologie
sur le concept dĠintentionnalit, adaptant par exemple la conception du signe
peircien en se donnant comme dfinition de lĠindice, du signal, du symbole et
du signe le degr dĠintentionnalit croissante dans leur production.
Trop limite dans ses objets, elle est tombe
en dsutude.
Smiologie du cinma
Son fondateur, Christian Metz, tait proche de Greimas. Il a construit sa thorie, entre autre en transposant certains des concepts narratifs labors ces cts. Il a ensuite produit des dveloppement propres aux besoins de lĠanalyse des films, tout en gardant un certain temps des liens avec la linguistique.
1.3 Evolution
des applications, la smiotique greimassienne
Outre le dveloppement thorique, la
smiotique greimassienne sĠest dĠabord applique au rcit, d la dimension
narrative des textes[5].
Ensuite la smiotique sĠattaque aux discours et commence sa 1re
diversification. A ct de travaux sur le discours littraire, dĠautres travaux
mergent notamment sur le discours religieux, le discours politique, lĠanalyse
picturale, la communication et le marketing.
1.4 Annexe
1 une prsentation historique et conceptuelle de la smiotique
Article de Franois Rastier pour le Dictionnaire
des Notions Philosophiques.
Smiotique vient du grec smeion, signe. DĠabord terme de mdecine
dsignant lĠtude des symptmes. Locke tend semiotics lĠensemble des signes.
Cet emploi est repris par Peirce. Saussure utilise smiologie dans un sens
analogue, suivi par Hjelmslev qui emploie smiotique pour dsigner tout systme
de signes. Le 1er congrs de lĠAssociation Internationale de Smiotique a tranch pour smiotique mais lĠusage de smiologie subsiste . On convient aujourdĠhui quĠil revient Peirce
(1839-1914) et Saussure (1847-1913) dĠavoir fond la smiotique
moderne.LĠoriginalit de Saussure est quĠil a pens la smiotique partir de
la linguistique et non au sein dĠune philosophie. En revanche la smiotique de
Peirce est insparable de lĠensemble de sa philosophie. Charles Morris
dveloppe le projet Saussurien et va plus loin en divisant la smiotique en
syntaxe, smantique et pragmatique[6].
Son processus de constitution nĠtant pas
achev, la smiotique ne dispose pas dĠune problmatique unifie et ne repose
pas sur une vritable communaut scientifique.
Quatre conceptions rivalisent :
-
objet = syst. de signes
intentionnels humains non linguistiques (Mounin)
-
objet = le langage ;
science qui tudie la vie des signes au sein de la vie sociale et dont la ling.
nĠest quĠune partie. Thorie scientifique qui doit pouvoir servir de norme
toutes les sciences humaines. (Saussure puis Hjelmlev et Greimas)
-
tude de la
signification : le monde signifie dans la mesure o nous oprons des
infrences[7]
son propos. Philosophie de la signification traitant non seulement des
langues et des signes, mais de la rfrence, de la vrit, de lĠinfrence.
(Peirce, Eco)
-
thorie smiotique de la
biognse et de la covolution ; philosophie de la nature
2/ Les
principaux concepts de la thorie greimassienne
2.1 Parcours
gnratif de la signification
2.1.1
Une carte pour le
territoire smiotique
Le parcours gnratif est une concentration des diverses rflexions mthodologiques et thoriques de la smiotique greimassienne. Il permet de se reprsenter schmatiquement la thorie dĠensemble. C Ôest une sorte de carte permettant de sĠy retrouver lors du cheminement travers les divers aspects de la thorie.
Le parcours gnratif de la signification apparat dans sa frome acheve et aujourdĠhui canonique dans le 1er tome du dictionnaire o Greimas essaye de rassembler, sous une forme schmatique, lĠensemble des ides quĠil a dveloppes jusquĠalors. Les diffrents tages du PG correspondent des tats diffrents de la thorie, et aussi diffrents niveaux dĠabstraction.. Dans lĠidal ce parcours se suit du haut vers le bas cd du plus abstrait au plus concret, des valeurs les plus simples et les plus profondes[8] vers leurs manifestations les plus complexes[9].
![]()
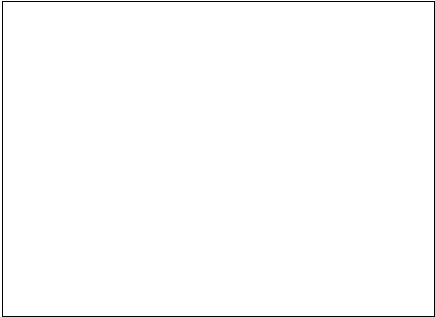 PARCOURS GENERATIF
PARCOURS GENERATIF
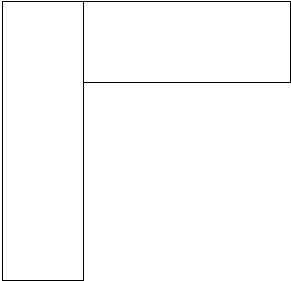
Composante Composante
Syntaxique Smantique
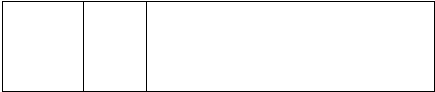
Niveau SYNTAXE SEMANTIQUE
Sructures profond FONDAMENTALE FONDAMENTALE
![]() Smio-
Smio-
Narratives niveau de SYNTAXE NARRATIVE SEMANTIQUE
surface DE SURFACE NARRATIVE
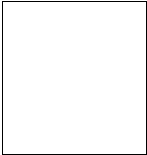
SYNTAXE SEMANTIQUE
DISCURSIVE DISCURSIVE
Structures Discursivisation Thmatisation
![]()
![]()
![]() Discursives
Discursives
Actorialisation
Temporalisation Figurativisation
Spatialisation
Courts, Greimas, 1979
2.1.2
Pourquoi
gnratif ?
Le parcours est
dit gnratif en vertu dĠun postulat :
Ç Tout objet smiotique
(peut) tre dfini selon le mode de sa production, les composantes qui
interviennent dans ce processus sĠarticulent les unes avec les autres selon un
Ç parcours È qui va du plus simple au plus complex, du plus abstrait
au plus concret È (Couts, Greimas, 1979)
Le parcours sert
tout autant, voire plus, dcrire la rception de la signification plutt que
la production. Il nĠest gnratif quĠen tant que reconstitution de la
production de la signification. Lors du processus dĠanalyse on remonte en
quelque sorte le parcours pour reconstruire le niveau discursif, puis le niveau
narratif, puis enfin les valeurs profondes qui mergent progressivement de
lĠanalyse. (ex. avec ÔCendrillonĠ, cf cours pg 21/22)
2.2 La
dimension narrative : petite histoire et principaux concepts
2.2.1 La morphologie du conte de Propp comme origine de la
smiotique narrative
Le folkloriste russe Propp
(1895-1970) inaugure lĠanalyse structurale du conte. Il fonde sa morphologie[10]
du conte sur un corpus de contes traditionnels russes. Il sĠattache reprer
le jeu des ÔvariablesĠ (noms et attributs des personnages) et des ÔconstantesĠ
(les fonctions[11] quĠils
accomplissent). Au terme de son analyse il conclut que le conte merveilleux
obit une structure unique : il tablit une liste de 31 fonctions qui
sĠenchainent dans un ordre identiques mme si elles ne pas toutes toujours
prsentes. Il dit que ce qui change ce sont les noms, pas les actions et les
fonctions. Propp considre que ce
sont les fonctions des personnages qui remplissent le rle de constantes dans
une morphologie du conte. Pour dfinir les fonctions il ne faut pas tenir
compte du personnage excutant mais uniquement du substantif exprimant lĠaction
(interdiction, interrogation, ..). Des actes identiques peuvent avoir des
significations diffrentes !
2.2.2 Greimas lecteur de Propp : vers une plus grande
abstraction
La principale objection de
grimas vis vis du modle morphologique de Propp est lie la dnomination
des fonctions. Pour Greimas elle reste trop figurative et ne correspond pas au
langage scientifique rigoureux. Le travail de reformulation de grimas commence
par la description de ce quĠil considre tre la structure minimale pour quĠon
puisse parler de rcit (rcit minimal).
DĠaprs Hjelmslev il faut
identifier des lments et la relation quĠils contractent ; cĠest cette
relation entre au moins 2 lments qui sera considre comme constitutive du rcit
minimal.
Greimas propose dĠutiliser
la notion dĠactant, qui permet
dĠindiquer la simple valeur syntaxique des lments. Il distingue lĠactant
sujet et lĠactant objet.
La relation quĠentretiennent
2 actants sera dite de jonction.
Si elle est positive elle sera dite conjonction, si elle est ngative elle sera dite disjonction.
LĠtape suivante consiste considrer comme
un nonc dĠtat la formule : Sujet jonction Objet.
Dans le cas dĠune jonction positive on aura : Dans
le cas dĠune jonction ngative on
aura :
Sujet conjonction Objet S O Sujet disjonction Objet S U O
¤
Exemples simples
dĠillustration (exemple plus complexe dans le cours pg 25) :
- je suis fatigu, jĠai
soif, je mange une pomme, sont considrs
comme des tats conjonctifs et dcrits narrativement par la formule suivante : S O
- elle nĠa pas peur, il
nĠa pas de voiture, ils ne partent pas,
sont considrs comme des tats disjonctifs et dcrits narrativement par la
formule suivante : S U O
Il est important de noter
que le niveau narratif est indpendant de la structure grammaticale ainsi que
de la dimension figurative.
¤
Autre cas :
LĠnonc Ç il nĠa
plus de voiture È prsuppose quĠil
avait une voiture mais quĠune action a t entreprise et qui lĠen a priv. Ce
nĠest plus un tat mais 2 : lĠtat 1, initial, de conjonction avec la
voiture et lĠtat 2, final, de disjonction avec la voiture. En smiotique
greimassienne on dira quĠentre ces 2 tats il y a transformation ; pour en
rendre compte Greimas parle dĠnonc de faire.
Dans Ç il est
mort È, lĠtat 1 nĠest pas manifeste
dans lĠnonc (il tait vivant) mais il doit avoir exist pour que lĠnonc
soit possible. On dira que lĠtat 1 est prsuppos par lĠtat 2 et quĠinversement lĠtat 2 prsuppose lĠtat 1. On dira que lĠtat 1 est logiquement
antrieur lĠtat 2.
¤
Autre cas : Ç il
a t emport par une longue maladieÈ
![]() Narrativement on a toujours le mme schma : tat 1 S (il) est conjoint O (la vie), tat 2 S est disjoint
de O. Mais on peut considrer que la
maladie est la cause de la mort cd que lĠaction de la maladie caus la mort.
Narrativement on pourra reprsenter a lĠaide dĠune nouvelle formule qui fait
intervenir une nouvelle fonction la relation factitive, le faire, et un
nouvel actant, le sujet de faire. On
reprsentera donc la formule suivante : F
[S1 (S2 U
O)] o :
Narrativement on a toujours le mme schma : tat 1 S (il) est conjoint O (la vie), tat 2 S est disjoint
de O. Mais on peut considrer que la
maladie est la cause de la mort cd que lĠaction de la maladie caus la mort.
Narrativement on pourra reprsenter a lĠaide dĠune nouvelle formule qui fait
intervenir une nouvelle fonction la relation factitive, le faire, et un
nouvel actant, le sujet de faire. On
reprsentera donc la formule suivante : F
[S1 (S2 U
O)] o :
S1 = maladie
S2 = il et O = mort
![]() Reprsente
lĠaction de S1 (sur S2)
Reprsente
lĠaction de S1 (sur S2)
![]() La transformation conjonctive sĠcrira : F [S1 (S2 O)] (ex. :
lĠenfant est guri)
La transformation conjonctive sĠcrira : F [S1 (S2 O)] (ex. :
lĠenfant est guri)
La transformation est
considre comme la fonction narrative de base[12].
Par convention on notera S1 le sujet de faire et S2 le sujet dĠtat. On dit en smiotique quĠun nonc de
faire rgit un nonc dĠtat. Pour quĠil y ait une progression narrative il
faut quĠil y ait des transformations successives. LĠanalyse narrative va
consister, pour une part, reprer dans le texte les noncs de faire qui
rgissent les noncs dĠtat.
2.2.3 Diffrence entre actant et acteur, transformations
transitives et rflexives
On distingue 2 types de sujets :
Celui qui ralise lĠaction est un sujet de faire, appel sujet oprateur (qui opre la transformation),
Celui qui bnficie de lĠaction ou qui la subit est un sujet dĠtat, parfois appel bnfacteur (au sens o il est le bnficiaire)
Les questions relatives la dimension
narrative (dont relvent les notions dĠactants sujet et objets) se traitent au
niveau de surface des structures smio-narratives. Les questions concernant
lĠacteur (= une entit figurativise) se traitent au niveau des structures
discursives.
![]() Transformation rflexive : le sujet de faire et le sujet dĠtat correspondent au
mme acteur. Ex. : Julie sĠest offert une montre F [S1 (S2 O)] (o S1 et S2 =
Julie et O = la montre). Lorsque les
rpoles de sujet dĠtat et de sujet de faire sont assums par un mme acteur on
parlera de syncrtisme actanciel.
Transformation rflexive : le sujet de faire et le sujet dĠtat correspondent au
mme acteur. Ex. : Julie sĠest offert une montre F [S1 (S2 O)] (o S1 et S2 =
Julie et O = la montre). Lorsque les
rpoles de sujet dĠtat et de sujet de faire sont assums par un mme acteur on
parlera de syncrtisme actanciel.
![]() Transformation transitive : le sujet de faire et le sujet dĠtat correspondent des
acteurs diffrents. Ex. : Gilbert a offert une montre Julie F [S1 (S2 O)] (o S1 =
Gilbert, et S2 = Julie et O = la montre).
Transformation transitive : le sujet de faire et le sujet dĠtat correspondent des
acteurs diffrents. Ex. : Gilbert a offert une montre Julie F [S1 (S2 O)] (o S1 =
Gilbert, et S2 = Julie et O = la montre).
2.2.4 Le programme narratif (PN)
Le PN Ç est un syntagme lmentaire de
la syntaxe narrative de surface, constitu dĠun nonc de faire et dĠun nonc
dĠtat È (Courts, Greimas, 1979). On le reprsente ainsi :
![]()
![]() PN = F [S1 (S2 O)] ou ainsi PN = F [S1 (S2
U O)]
PN = F [S1 (S2 O)] ou ainsi PN = F [S1 (S2
U O)]
Le 1er PN sera dit dĠacquisition, le 2nd de privation.
Acquisition transitive = attribution :
il sĠagit dĠacqurir un objet pour quelquĠun qui nĠest pas soi.
Acquisition rflchie = appropriation :
lĠoprateur (le sujet de faire) est en syncrtisme avec le bnfacteur (le
sujet dĠtat)
Privation transitive = dpossession :
le sujet oprateur fait en sorte que le sujet dĠtat, qui est diffrent de lui,
soit priv de lĠobjet)
Privation rflchie = renonciation :
le sujet de faire se prive lui mme – sujet dĠtat- de lĠobjet
![]() La trouvaille est
une attribution dont on ne peut pas dterminer, au niveau discursif,
lĠacteur qui prend en charge le sujet de faire. Sa
formule sera : F
[ ? (S2 O)]
La trouvaille est
une attribution dont on ne peut pas dterminer, au niveau discursif,
lĠacteur qui prend en charge le sujet de faire. Sa
formule sera : F
[ ? (S2 O)]
![]() La perte est une privation
dont on ne peut pas dterminer, au niveau discursif, lĠacteur qui prend en
charge lĠactant sujet de faire. Sa formule sera : F [ ? (S2 U O)]
La perte est une privation
dont on ne peut pas dterminer, au niveau discursif, lĠacteur qui prend en
charge lĠactant sujet de faire. Sa formule sera : F [ ? (S2 U O)]
Schma dĠensemble permettant
de comprendre comment les diffrentes formules narratives se distribuent
hirarchiquement :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() (jonction)
(jonction)
(conjonction)
(disjonction)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() acquisition
privation
acquisition
privation
(transitive) (rflchie)
(transitive)
(rflchie)
attribution
appropriation
dpossession
renonciation
![]()
![]()
![]()
![]() preuve
preuve
don
Les diffrents programmes narratifs[13]
basiques [14]
2.2.5 Composante narrative : schma dĠensemble
Le schma narratif canonique
est la reprsentation de la structure narrative dĠensemble dĠun rcit.
Conformment au principe de prsupposition, il reprsente la relation
quĠentretiennent les diffrents PN entre eux par une flche oriente de droite
gauche, pour signifier la relation de lĠeffet vers la cause.
Contrat
Objet de valeur
![]() Manipulation
Sanction
Manipulation
Sanction
Dessinateur-manipulateur
Destinateur-judicateur
![]()
![]()
![]()
![]() Action
Action
Destinataire
![]()
![]() Comptence
Performance
Comptence
Performance
Chacunes des tapes de ce
schma est constitue dĠun programme narratif, et donc dĠune transformation
principale qui est le moteur de lĠvolution du rcit.
2.2.6 Les modalits de faire
La question de la comptence
a suscit le plus vif intrt des smioticiens. Elle correspond la rflexion
mene sur les modalits du faire. Elles sont, pour la smiotique greimassienne,
au nombre de 4 (si lĠon excepte le faire lui-mme), et sont rparties selon 3
modes dĠexistence smiotique[15] :
le virtuel, lĠactuel et le ralis.
Les modalits de faire
aident spcifier la valeur des lments du programme narratif considr. En
effet, pour raliser quelque chose, il faut dĠabord quĠelle soit dĠabord
dĠactualit, et pour cela quĠelle ait une existence pralable, mme virtuelle.
Entre un projet et sa ralisation, par ex., il peut se passer du temps :
le temps de concevoir lĠide mme du projet (modalits virtualisantes), puis de
se donner les moyens de le raliser (modalits actualisantes), puis enfin celui
de sa ralisation effective (modalits ralisantes).
2.3 Une
application de la mthodologie narrative au Ç Petit Poucet È
Prsentation dĠune analyse
narrative du PetitPoucet (pages 31 43) avec une squence (sq. 1, Perdus par
les parents, nonc pg 43, texte pg32-33) non analyse pour permettre un
entrainement personnel.
3/ Introduction
la smiotique discursive : lĠnonciation
Etude de 2 textes de Franois Salvaing :
-
Ç Cap Caubre È qui
sera le terrain dĠapprentissage
-
Ç Grenache È qui
sera le terrain dĠexercice renvoyer la correction.
3.1 lĠnonciation
en smiotique
Il y a 2 manires dĠenvisager la question de
lĠnonciation :
La premire consiste la considrer comme
une structure rfrentielle qui sous-tend la communication. On parlera alors de
situation de communication, de contexte socio-psychologique et le concept
dĠnonciation aura tendance se rapprocher de celui dĠacte de langage.
La 2me consiste la considrer comme une
instance linguistique, voire langagire et
lĠon considrera alors que lĠnonciation est prsuppose par lĠexistence dĠun
nonc et quĠon peut en rcuprer les traces et reconstituer le parcours
partir de celui-ci. (cĠest cette 2nd manire qui sera retenue ici).
3.1.1
LĠopration
nonciative fondamentale : le dbrayage
Ç On peut concevoir lĠinstance de
lĠnonciation comme le syncrtisme[16]
de 3 facteurs : je-ici-maintenant. LĠacte dĠnonciation proprement dit
consistera alors, grce la procdure dite de dbrayage, abandonner, nier
lĠinstance fondatrice de lĠnonciation et faire surgir, comme par
contre-coup, un nonc È (Courts, 1991)
CĠest une consquence de ce que lĠon appelle
en smiotique le principe dĠimmanence, qui est dj manifest dans la phrase
culte de Saussure Ç la linguistique tudie la langue en elle-mme et pour
elle-mme È. Chez Greimas et Courts cela prend la forme suivante :
Ç lĠobjet de la linguistique tant la forme, tout recours aux faits
extra-linguistiques doit tre exclu, parce que prjudicianle lĠhomognit de
la description È.
Le dbrayage est le geste fondamental de
lĠnonciation linguistique ou smiotique, prsuppos par lĠexistence de
lĠnonc : (schma de J. Courts)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() Je dbrayage actanciel non je (=
il)
Je dbrayage actanciel non je (=
il)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() Enonciation ici dbrayage temporel non ici (= ailleurs) nonc
Enonciation ici dbrayage temporel non ici (= ailleurs) nonc
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() Maintenant dbrayage spatial non
maintenant (= alors)
Maintenant dbrayage spatial non
maintenant (= alors)
Il faut distinguer lĠnonciation relle
(proprement dite) de lĠnonciation nonce (un simulacre dĠnonciation).
Ç Le mode dĠexistence de lĠnonciation
proprement dite est dĠtre le prsuppos
logique de lĠnonc et lĠnonciation nonce (ou rapporte) nĠest que le simulacre imitant,
lĠintrieur du discours, le fait nonciatif. È (Greimas, Courts,
Dictionnaire)
3.1.2
Enonciation nonce
et nonc nonc : le simulacre nonciatif
Dans le cadre de la problmatique de
lĠnonciation on ne sĠoccupe pas du sujet rel de lĠnonciation mais des simulacres
nonciatifs. Si cĠest Ç quelque
chose È dĠautre qui simule la prise de parole, on parle, en smiotique, de
simulacre nonciatif. Un embrayage est la manifestation dĠune instance
nonciative simule.
Il nĠest nullement besoin que toutes les
composantes nonciatives soient ralises pour quĠon puisse construire la
structure de lĠnonciation nonce.
La construction dĠensemble de lĠnonciation
nonce relve dĠune stratgie nonciative.
3.1.3
Typologie
nonciative
Prsentation de la typologie narrative de
Grard Genette, principale alternative la mthodologie smiotique elle est
presque plus utilise que cette dernire avec qui elle est compatible sur bien
des points.
3.1.3.1
Le pragmatique et le
cognitif
Les 2 dimensions se dfinissent lĠune par
rapport lĠautre et sont conues dans une relation hirarchique. La dimension
cognitive est considre comme hirarchiquement suprieure parce quĠelle permet
la prise en charge, par le savoir, des actions pragmatiques.
Ç La dimension cognitive sert de
rfrent interne la dimension pragmatique qui est en gros la description
faite dans les rcits des comportements somatiques[17]
signifiants È . Ç La dimension cognitive du discours se dveloppe
paralllement avec lĠaugmentation du savoir attribu aux sujets installs dans
le discours. Si la dimension pragmatique nĠappelle pas ncessairement la
dimension cognitive, la rciproque nĠest pas vrai : la dimension cognitive
prsuppose les actions pragmatiques È.
Valeur modale :
La dimension cognitive, si elle ne change pas fondamentalement lĠaction, change toute la valeur de lĠaction (ex. pg 49 du cours).
Dimension pragmatique = actions mises en place
Dimension cognitive = gestion des savoirs et des ignorances
La smiotique essaye de distinguer ce qui relve du cognitif [18], au sens strict du terme, dans la procdure nonciative, de ce qui relve du perceptif [19].
3.1.3.2
LĠaspectualisation
et lĠinstance nonciative
á
LĠobservateur, un actant
cognitif de lĠnonciation
Ç On appellera observateur le sujet cognitif dlgu par lĠnonciateur et install
par lui, grce aux procdures de dbrayage, dans le discours-nonc o il est
charg dĠexercer le faire rceptif et, ventuellement le faire interprtatif de
caractre transitif[20]È.
LĠobservateur peut tre implicite. Il ne peut alors tre reconnu que par
dduction, aprs analyse des configurations discursives du rcit. Ç Il
peut rester implicite et nĠest alors reconnaissable que grce lĠanalyse
smantique qui dvoile sa prsence lĠintrieur dĠune configuration
discursive È.
Une instance ne devient vnement que par ce quĠelle est reporte par
une instance nonciative. Lorsque nous lisons une histoire, les actions de
cette histoire sont des vnements de lĠnonc[21]
parce quĠelles nous sont prsentes comme tels par une instance nonciative. En
reconnaissant les marques de cette nonciation[22]
on reconnat (on reconstruit) une instance nonciative minimale : lĠobservateur.
Par exemple, lĠorganisation temporelle des vnements les uns par rapport aux autres est le fait dĠun observateur. Les lments de structuration de lĠespace peuvent eux aussi donner des indices de ÔprsenceĠ dĠun observateur. LĠvaluation de la distance relve par exemple dĠun point de vue, au sens strict du terme, qui renvoie une instance nonciative qui observe la scne prsente. De la mme manire, lĠexpression dĠune opinion, dĠune valuation de la situation, est un indice de la ÔprsenceĠ dĠune instance nonciative.
La ÔprsenceĠ est un simulacre, cĠest pourquoi la prsence dĠun observateur ne peut tre assimile la prsence effective dĠun nonciateur rel. LĠobservateur nĠest quĠune place dans la syntaxe figurative, une position dans le dispositif nonciatif simul par tout nonc. Cependant, en nommant observateur cette instance reconstruite on lui donne quand mme en quelque sorte Ôforme humaineĠ.
La smiotique conoit la structuration du sens dĠun point de vue gnratif ; la mise en discours consiste alors installer dans le discours des structures narratives (commes les actions) et les ÔhabillerĠ. ÔHabillerĠ des structures narratives cĠest avant tout leur donner Ôforme humaineĠ ou plus largement les rapporter un chelle humaine : les actions ainsi transformes deviennent des procs, les actants narratifs des acteurs discursifs et les programmes narratifs des parcours figuratifs.
á
LĠaspectualisation :
procdure gnrale de la mise en discours
Ç Historiquement,
lĠaspect sĠintroduit en linguistique comme Ôle point de vue sur lĠactionĠ
susceptible de se manifester sous forme de morphmes grammaticaux
autonomes È. Ce Ôpoint de vueĠ est reconstruit par lĠanalyse partir des
diverses configurations discursives que celle-ci permet de reprer.
LĠobservateur nĠest quĠune faon de nommer ce Ôpoint de vueĠ et le rapport
une instance qui tend rendre homogne sa prsentation.
Dans le cadre du parcours
gnratif, on entendra par aspectualisation la mise en place, lors de la
discursivisation, dĠun dispositif de catgories aspectuelles par lesquelles se
rvle la prsence implicite dĠun actant observateur. Cette procdure eqst
gnrale et caractrise les 3 composantes dĠactorialisation, de spatialisation
et de temporalisation, constitutives des mcanismes du dbrayage. Dans la mise
en place des catgories aspectuelles la dimension temporelle est prdominante.
á
Les catgories
aspectuelles : prdominance de lĠaspectualisation temporelle
Les catgories
aspectuelles (temporelles) mises en place lors de la discursivisation sont
prsentes par Greimas et Courts comme des smes, qui se distribuent de la
faon suivante : durativit, ponctualit, perfectivit et imperfectivit[23],
inchoativit et terminativit[24].
Ces catgories sont classables en micro-oppositions : durativit /
ponctualit[25],
perfectivit / imperfectivit, inchoativit / terminativit.. On peut aujourdĠhui ajouter ces oppositions le couple
de contradictoires itrativit / semelfactivit, qui caractrise lĠaspect rptitif ou unique dĠun procs
temporel.
Ces distinctions
catgorielles nĠpuisent pas le champs de lĠaspectualit, elles tentent juste
de les cartographies sommairement. Ces catgories sont combinables[26]
pour former une configuration aspectuelle cd Ç un dispositif de smes
aspectuels mis en place pour rendre copte dĠun procs È.
Le but dans lĠanalyse
sera de reprer de tels dispositifs et de les interprter, cd de montrer le
sens quĠils donnent lĠnonc tudi.
á
Aspectualisation spatiale
Ç Un discours
spatialis peut aussi tre aspectualis si divers lieux sont mis en relation
par le mouvement ou par la vue des sujets de lĠnonc ; les catgories de
la distance peuvent tre considres comme quivalentes celle de la dure
dans lĠaspectualisation temporelle : si 2 lieux sont ÔdistantsĠ,
lĠobservateur enregistrera successivement le dpart du 1er lieu
(inchoatif), le ÔcheminementĠ (duratif) puis lĠarrive dans le 2nd
lieu (terminatif) ; figurativement la distance peut tre remplace par un
mur, un quelconque obstacle au dplacement, qui divise lĠespace en 2 lieux
distincts È.
LĠchelle anthropomorphe[27]
laquelle renvoie lĠaspectualisation peut en outre tre mieux comprise si lĠon
se rfre la comptence perceptive de lĠobservateur : Ç il È
voit la scne de lĠnonc, mais il peut galement la toucher, la sentir,
lĠentendre. Chacunes de ces perceptions reprsentes renvoient une
apprhension diffrente de lĠespace, et peuvent, de ce point de vue, relever de
lĠaspectualisation spatiale.
á Quelques pistes pour une aspectualisation actorielle
Ç LĠactorialisation peut sĠaccompagner
dĠune aspectualisation si, par exemple, les acteurs de lĠnonc modifient leur
faon de raliser une performance, ou, en dĠautres termes, si, sans que leur
comptence soit remise en cause, ils se ÔperfectionnentĠ ou ÔmrissentĠ,
faisant aisment ce quĠils faisaient difficilement auparavant, par
exemple È.
Les variations de lĠactorialisation doivent
tre comprises come des indices de lĠaspectualisation actorielle : le
passage, par exemple, dĠun auteur collectif un auteur individuel, et
vice-versa, est une aspectualisation actorielle assimilable au passage de
lĠitratif au semelactif au niveau temporel. Ainsi il faudra tudier de prs
toute variation nonciative ds lors que lĠinstance nonciative est identifie
un acteur.
3.1.3.3 Premire typologie des observateurs
á Dpart
JusquĠici lĠobservateur tt dduit dĠune
organisation discursive particulire, temporelle ou spatiale, sans dĠautres
formes dĠindices que les lments temporels ou spatiaux de structuration des
vnements relats. Mais il y a le cas o lĠobservateur est plus explicite, cd
lorsquĠil est manifest comme une personne, un simulacre actoriel.
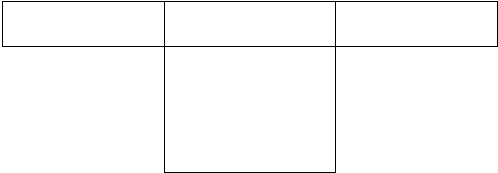
Dfinition
du type Dnomination
du type Dnomination
du type
dĠobservateur de
narrateur

actant
de discursivisation FOCALISATEUR (Foc) (avec
parcours de verbalisatĦ)
reconstructible
par lĠanalyse
ASPECTUALISATEUR
(Asp) NARRATEUR
![]()
Acteur
virtuel, impliqu par SPECTATEUR
(Sp) RAPPORTEUR
la
deixis spatio-temporelle
![]()
Acteur
actualis dans lĠnonc ASSISTANT (As) TEMOIN
Le focalisateur htrogninise lĠobjet cognitif (lĠnonc) par dbrayage.
LĠaspectualisateur homogninise lĠinformateur par embrayage.
Le passage dĠun type
dĠobservateur lĠautre est la manifestation dĠune aspectualisation actorielle,
traite par la suite sous la dnomination de stratgie nonciative.
á Suite
Ç La classification des types
dĠobservateurs ne peut pas tre exhaustive ; pour rester maniable elle ne
doit retenir que les types statistiquement reprsentatifs.
Si le rle dĠobservateur nĠest pris en charge par aucun des acteurs du discours, et
si on ne lui attribue pas de deixis spatio-temporelle dans l Ônonc, il
reste abstrait, pur ÔfiltreĠ cognitif de la lecture. Ce nĠest quĠun actant de discursivisation, dnomm focalisateur (Foc), engendr par un simple dbrayage actanciel ; on le reconnat uniquement ce quĠil fait, cd aux
slections, aux focalisations / occultations mises en Ïuvre dans lĠnonc
Dans le cas o les limites de la comptence
du focalisateur reoivent une
manifestation figurative, cd quand les limites sont, entre autre, de type
spatial et temporel, lĠobservateur est directement impliqu dans les catgories
spatio-temporelles de lĠnonc. On lĠappellera ÔspectateurĠ (Spec).
Si le rle de focalisateur est pris en charge par un acteur de lĠnonc, dont
lĠidentit est reconnue, mais qui ne joue pas de rle (pragmatique et thymique[28])
dans les vnements de lĠnonc, ce sera un ÔassistantĠ (As). Il est dot dĠune enveloppe actorielle, et rsulte
par consquent dĠun dbrayage actoriel.
LĠ Ôassistant-participantĠ (As-Part) est, pour finir, un observateur qui rsulte
dĠun dbrayage complet (actanciel + spatio-temporel + actoriel + thmatique).
Cet observateur thmatis est, comme le dtective dans le roman policier,
susceptible de participer aux vnements de lĠnonc, soit comme figurant, soit
comme protagoniste È. (J. Fontanille, 1989)
Cette typologie prsuppose que le dbrayage
et lĠembrayage sont des oprations graduables.
Les distinctions tablies par J. Fontanille
permettent galement de diffrencier la comptence cognitive de la comptence
pragmatique de lĠinstance de lĠnonciation. La difficult avec la notion
classique de narrateur est quĠelle amalgame ces 2 comptences alors que leur
distinction peut apporter une finesse utile lĠanalyse.
Ç Sur la dimension cognitive de
lĠnonciation, lĠobservateur est lĠactant principal ; ses parcours et les
transformations de sa comptence permettent dans nombre de cas de rendre compte
des vnements nonciatifs.
Sur la dimension pragmatique de
lĠnonciation, on installera un actant responsable de la ralisation matrielle
de lĠnonc, dnomm, faute de mieux, ÔperformateurĠ. Selon que la matire de lĠexpression sera verbale, picturale
ou filmique, ce ÔperformateurĠ sera respectivement narrateur ou locuteur,
peintre, ralisateur ou filmeur.
Le narrateur ralisant sur la dimension
pragmatique les acquis cognitifs de lĠobservateur, on peut tablir la
terminologie suivante :
-
un focalisateur dot dĠun rle verbal sera appel Ç narrateur È
-
un spectateur dot dĠun rle verbal sera appel Çrelateur È
-
un assistant dot dĠun rle verbal sera appel Çtmoin È
-
un assistant-participant dot dĠun rle verbal sera appel Çtmoin-participant È È
Reste mettre en Ïuvre cette typologie lors
dĠune analyse. Elle nĠinvalide pas les propositions prcdentes mais les
complte ; le fait de distinguer un focalisateur, par exemple, ne donne
pas dĠindication sur la faon dont la focalisation est construite ; on a
identifi le phnomne mais lĠanalyse reste faire. On se servira de la
typologie fontanilloise soit pour fonder une hypothse interprtative, soit
pour vrifier une analyse et lui donner un point dĠaboutissement en une
instance nonciative identifie.
Synthse de la typologie : (cf tableau
pg 58 du cours)
4/ Analyse
smiotique applique au texte littraire
4.1 Prsentation
des textes soumis lĠanalyse
Etude dĠun extrait de Ç de purs dsastres È de Franois Salvaing
Ç NOUS VENIONS DE TEMPS A AUTRE, vrifier au Cap Caubre lĠide que nous avions de lĠimmensit. [É] e ciel ne venait nous dlier que pour nous remettre la nuit et toi, chien du rve, qui mords et qui remords. È
4.2 Exemples
dĠanalyses
Explication
de la dmarche suivre pour faire lĠanalyse du schma narratif du texte :
LĠide
est de partir du niveau narratif pour arriver au niveau discursif. En
sĠobligeant se focaliser sur la seule dimension narrative, on peut esprer faire
ressortir une structure (hypothtique) sur laquelle se baser pour formuler une
interprtation du niveau discursif.
Une
analyse smiotique aujourdĠhui nĠest plus une analyse en soi, mais une partie
(gnralement initiale) dĠune analyse smiotique complte, comprenant les 2
niveaux du parcours gnratif de la signification (niveau des structures
smio-narratives, niveau des structures discursives)
Exercice renvoyer la correction : Schma narratif de
Ç Grenache È (2nd
texte)
4.3 La
discursivisation applique Cap Caubert
Actorialisation
Spatialisation
Temporalisation
Aspectualisation
Dtails explicatifs dans le
cours pges 61 63
5/ Analyse
smiotique applique au texte publicitaire
La smiotique greimassienne a
explor dĠautres domaines que les domaines littraires et ethnolittraires dans
lesquels elle avait fait ses 1res armes. Aprs avoir dvelopp sa mthode
(analyse narrative puis discursive) et, tout en lĠaffirmant, elle a esay de la
mettre en Ïuvre sur des textes diffrents, voire des objets smiotiques
non-verbaux, et notament des textes du champs publicitaire. CĠest
principalement Jean-marie Floch qui a dvelopp les liens entre smiotique t
publicit.
Schma gnral de
lĠinjonction publicitaire : un destinateur, reprsentant la marque, tente
de faire adhrer un destinataire, reprsentant le client potentiel, au systme
de valeurs mis en scne dans le rcit publicitaire, quel que soit sa forme
(affiche, sport, encart, ..). Le rcit publicitaire est toujours encadr par
une dimension nonciative labore laquelle il faut porter attention.
LĠanalyse se fait en 2
tapes : dans un 1er temps il faut traiter de lĠnonc nonc,
dans sa dimension narrative et discursive, dans un 2me temps il
faut triater du cadrage nonciatif de cet nonc nonc en tenant compte,
notament, des indications donnes par la mise en page[29].
Exemple dĠanalyse avec
une publicit des magasins ÔShopiĠ : Ç M. Picot a horreur de la
routine È. Schma : Mise en discours / Narrativit / Enonciation.